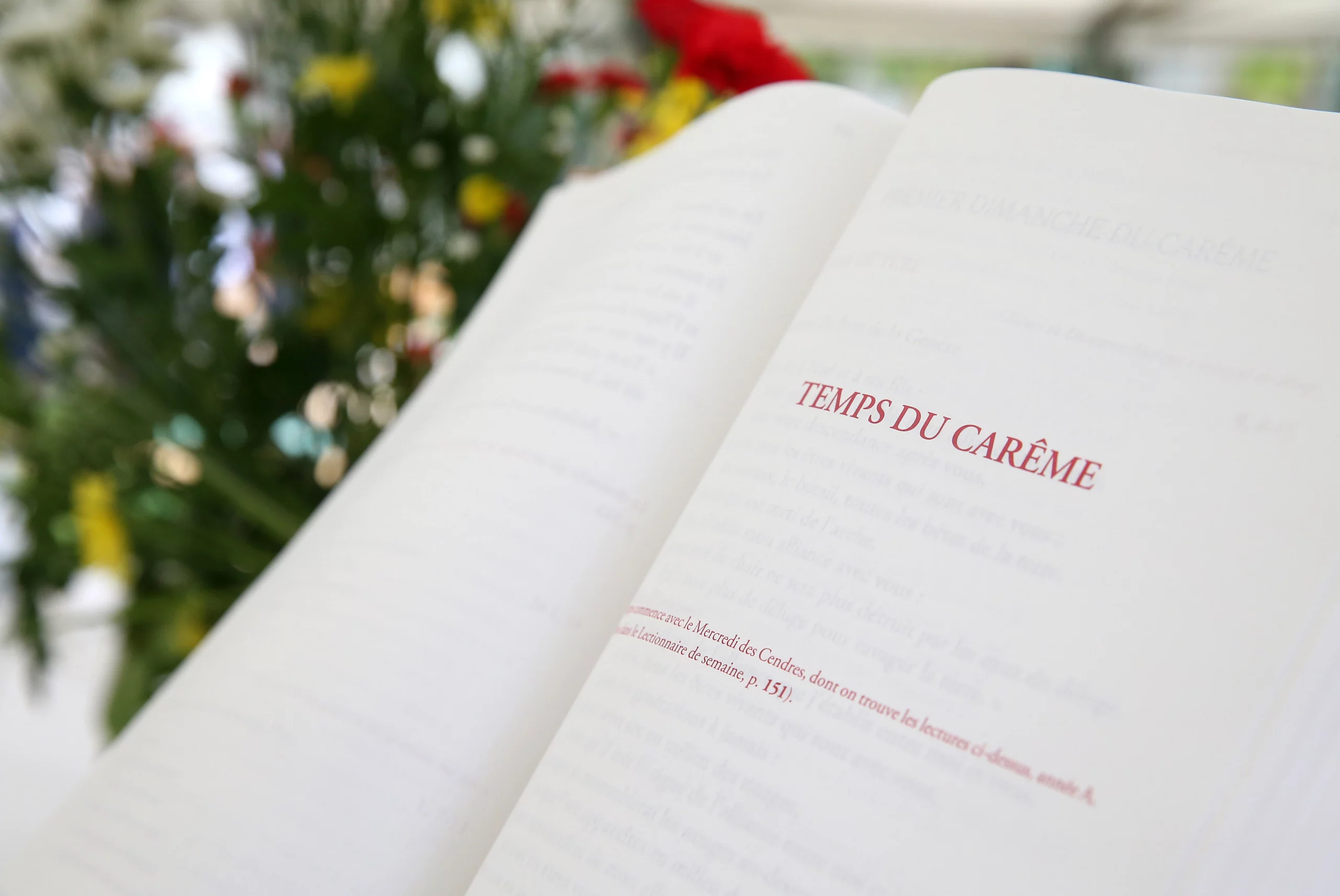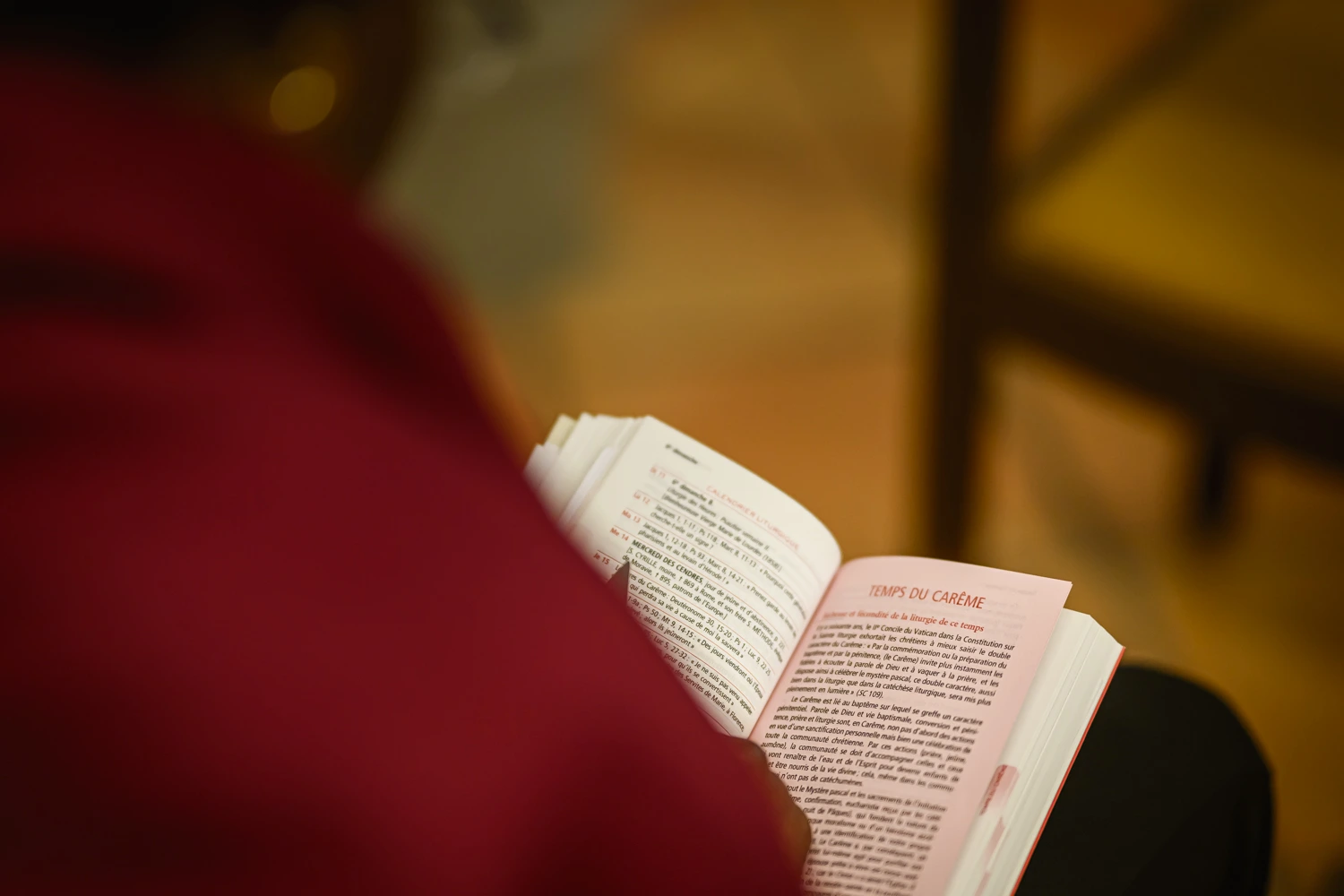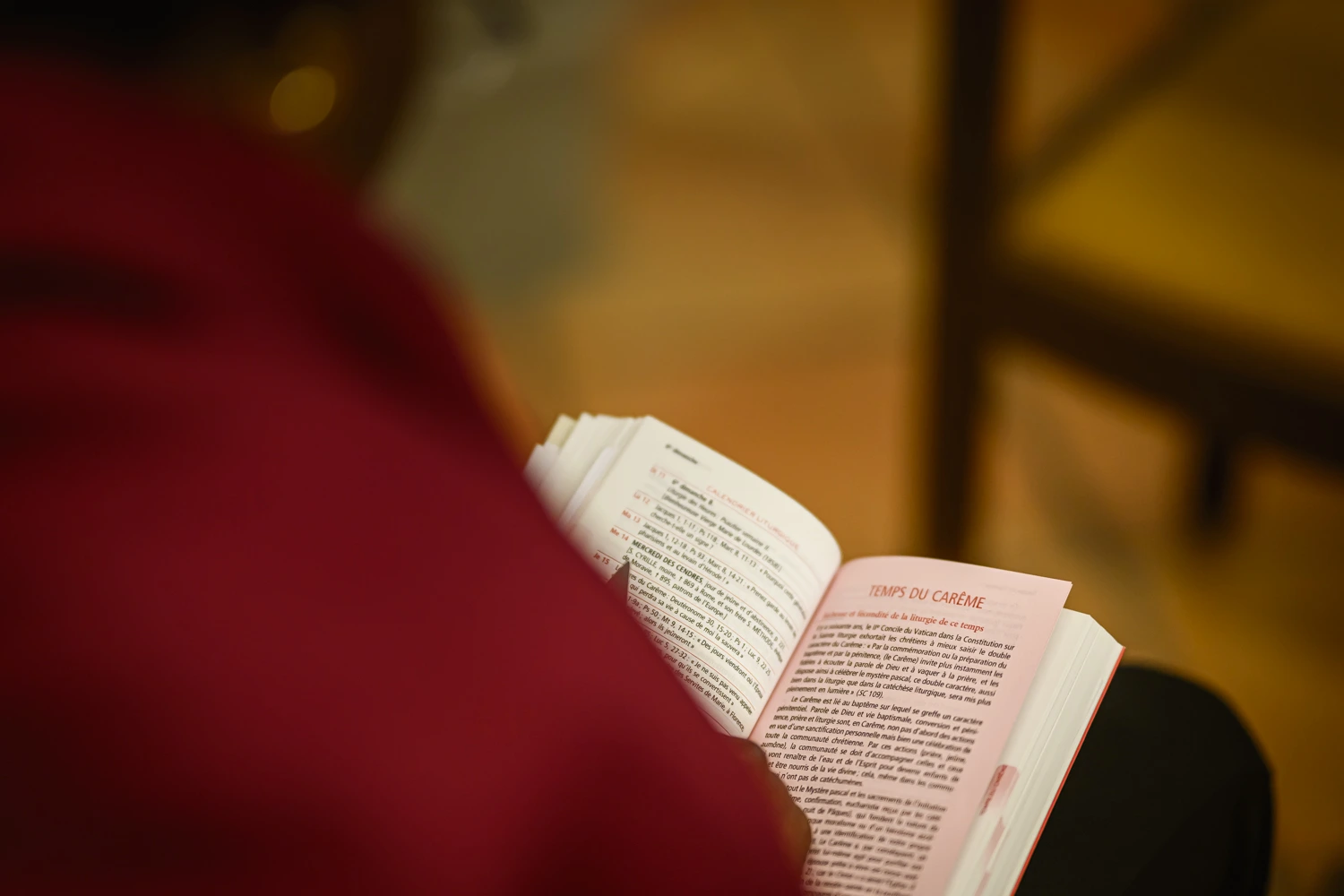Lorsqu’il est question du Carême, la thématique du jeûne se dessine naturellement. Qu’il soit alimentaire, consumériste ou axé sur la détoxification, ces pratiques méritent d’être examinées. Pour en approfondir la compréhension, entretenons-nous avec Isabelle Jonveaux, responsable de l’Institut suisse de sociologie pastorale en Suisse romande (SPI). Sociologue des religions, elle est notamment spécialisée dans l’étude de la vie consacrée contemporaine en Europe et en Afrique, ainsi que dans les interactions entre religion et Internet et les nouvelles formes d’ascèse.
D’où vient la coutume chrétienne de jeûner durant le Carême ?
Pour les chrétiens, le jeûne du Carême fait écho aux quarante jours que Jésus passa dans le désert, affrontant les tentations du diable. Cependant, la plupart des traditions religieuses intègrent des périodes de jeûne : associées à une forme d’ascèse, elles permettent de se préparer physiquement, mentalement et spirituellement à des moments particuliers, à une connexion avec un dieu, une divinité. Dans le christianisme, dès les IIe et IIIe siècles, cette pratique se rattache aux formes de renoncement adoptées dans le désert par les ascètes pour se rapprocher de Dieu. Le Concile de Nicée codifie ensuite le jeûne de Carême en 325.
Les chrétiens d’aujourd’hui jeûnent-ils encore durant le Carême ?
Oui, mais sous une forme différente. L’Eglise ne met plus l’accent sur le jeûne alimentaire et n’impose plus de restrictions strictes à ses fidèles. Elle invite toutefois à observer une certaine frugalité deux jours par an, lors du Mercredi des Cendres et du Vendredi Saint. À ces occasions, chacun est encouragé à réduire ses portions ou à sauter un repas, sans pour autant s’abstenir totalement de nourriture.
Un glissement s’est néanmoins opéré : aujourd’hui, de nombreuses personnes pratiquent un jeûne alimentaire, parfois rigoureux et prolongé, sans respecter nécessairement l’interruption du jeûne dominical où les chrétiens sont invités à fêter la résurrection du Christ. C’est là un paradoxe. D’autres formes de privation émergent également, comme le jeûne numérique ou consumériste. Durant le Carême, certains cherchent à se libérer de leur dépendance aux écrans et aux réseaux sociaux, une démarche parfois associée à un jeûne alimentaire.
Quels sont les effets rapportés par les pratiquants ?
De manière générale, le jeûne est perçu comme un moyen de purification du corps, de l’âme et de l’esprit. Lorsqu’il est motivé par des raisons religieuses, il vise à (re)trouver Dieu à travers le vide créé en soi. Beaucoup témoignent aussi d’un regain d’énergie.
Cependant, cette pratique peut s’avérer difficile. Les tentations alimentaires sont un défi, surtout lorsqu’on est seul à jeûner dans un groupe. À l’inverse, au sein d’une communauté, une forme de surenchère peut apparaître quant au nombre de jours de jeûne observés. Il est donc essentiel d’être en bonne santé avant d’entreprendre un jeûne prolongé et de s’interroger sur sa capacité – voire le besoin – à le soutenir dans la durée.
Crédit photo : Ana Kontoulis, site internet du SPI